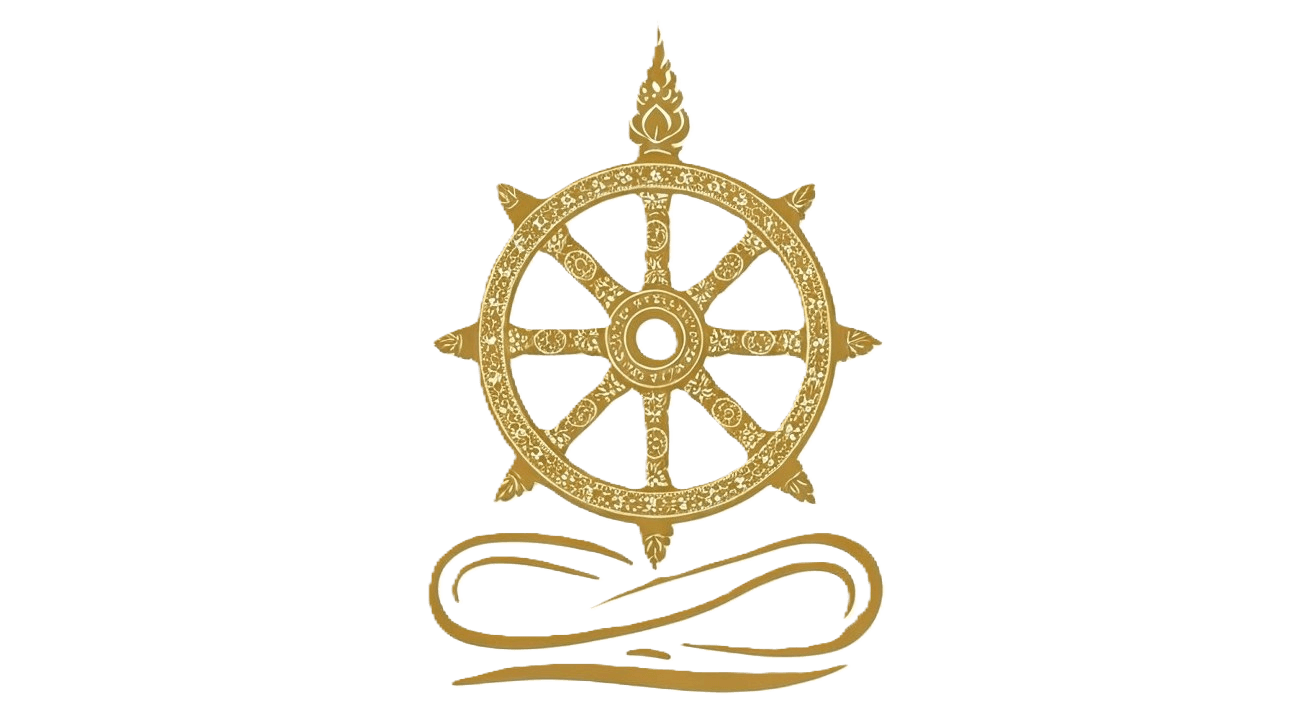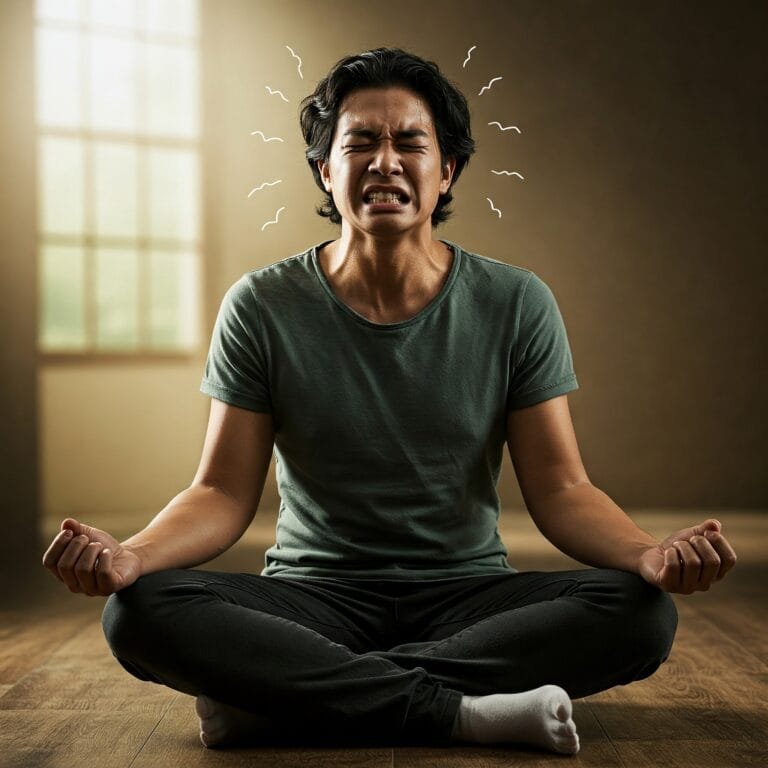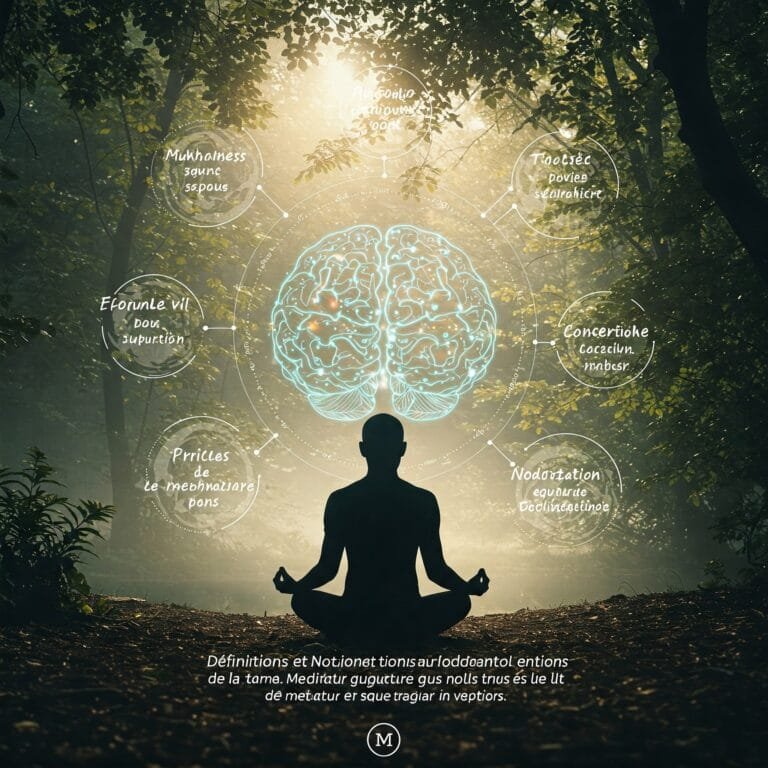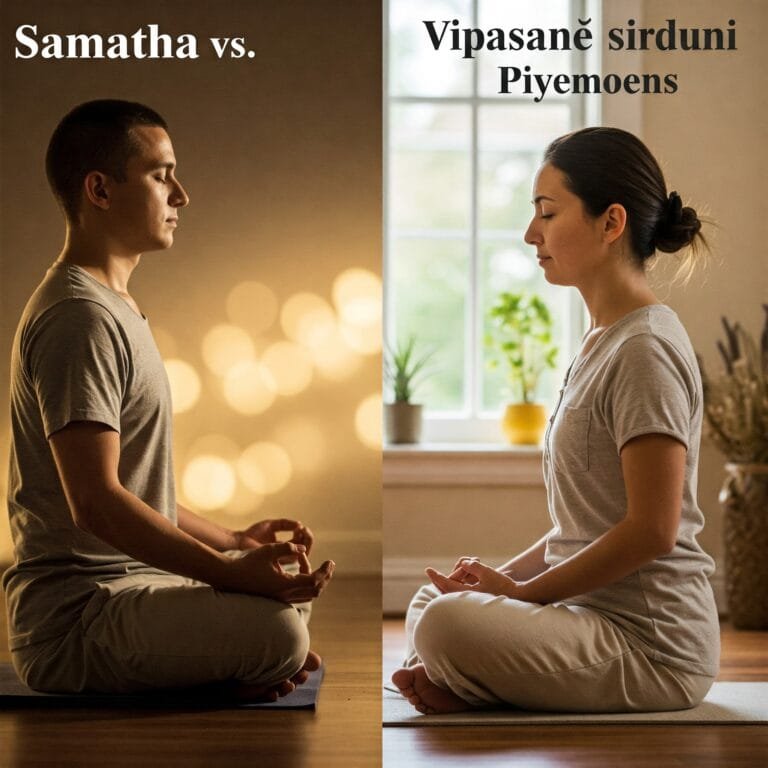Q : Comment pratique-t-on Vipassanā ?
R : Vipassanā est la claire vision de la réalité ultime de tous les Saṅkhāras (phénomènes). Tous les Saṅkhāras sont soumis à l’impermanence, la souffrance et le non-soi. L’attachement à une fausse idée de soi cause la souffrance et le cycle sans fin. Le pratiquant doit développer Samatha puis Vipassanā. Il existe trois degrés de calme mental : momentané, moyen et avancé (Appanā Samādhi) où l’esprit se débarrasse de certaines entraves.
Q : Quels sont les différents ārammaṇas (supports) de Vipassanā ?
R : Ils sont classifiés en 6 catégories principales, comprenant 76 supports au total appelés Vipassanā bhūmi. Ces catégories incluent les cinq agrégats (khandhas), les douze bases des organes de sens (āyatanas), les 18 substances primitives (dhātus), les 22 facultés (phénomènes physiques et mentaux), les 4 nobles vérités, et les 12 chaînons de la production conditionnée. On peut développer Vipassanā en méditant sur la nature de l’un de ces supports.
Q : Vous venez de parler des cinq agrégats, ce mot est nouveau pour moi, je voudrais bien quelques explications ?
R : Seul le Bouddha a parlé des cinq agrégats, contrairement aux autres religions qui ne mentionnent que le corps et l’esprit. Ce que les gens pensent être leur soi n’est rien d’autre que ces cinq agrégats. Le soi (attā ou Saṅkhāra) n’est pas créé mais naît par une combinaison de causes et disparaît quand les causes disparaissent. Les cinq agrégats sont : la matière (rūpakkhandha), la sensation (vedanākkhandha), la perception (saññākkhandha), les formations mentales (saṅkhārakkhandha), et la conscience (viññāṇakkhandha). La matière est composée des quatre éléments primaires. La sensation est le fait de sentir ce qui est agréable, désagréable ou neutre. La perception note ce qui est en contact avec les sens. Les formations mentales sont les réactions de l’esprit aux environnements. La conscience est le fait de connaître les phénomènes par les organes des sens. Ce qu’on prend pour un soi n’est qu’une combinaison de ces cinq agrégats, qui sont impermanents, insatisfaisants et sans soi.
Q : Comment font les pratiquants de vipassanā qui prennent comme support les 5 khandhas ?
R : À chaque instant, leur esprit observe ces 5 khandhas. Il faut voir comment ils sont impermanents, insatisfaits et sans soi. On réfléchit aux différentes caractéristiques de ces agrégats, du corps à la conscience et inversement. On peut se fixer sur un khandha particulier et observer comment il est formé, évolue et disparaît. On se remémore régulièrement ces supports pour s’apercevoir que les phénomènes sont impermanents, souffrants et sans soi. Cela développe la sagesse qui voit clairement la nature exacte des phénomènes. En observant la sensation par exemple, on voit qu’elle est impermanente et source d’insatisfaction et qu’elle évolue indépendamment de notre volonté, confirmant la notion de non-soi. Cela mène au détachement de la notion de soi et à la libération du désir d’existence ou de non-existence.
Q : On dit que dans le cas où le support de méditation est la sensation, il faut qu’on démarre depuis le sommet du crâne et qu’on descende, à chaque fois, de quelques millimètres et qu’à chaque instant il faut remarquer comment sont ces différentes sensations, leur nature, d’apparition et de disparition, leur durée: plaisant, déplaisant ou neutre, leur degré: très intense, intense, moyen ou négligeable.
R : Cette méthode de pratique est correcte. Chaque sensation naît du contact d’un organe de sens avec l’extérieur. C’est la conscience qui perçoit la sensation issue du contact entre organe interne et externe. Tous les contacts (phassa) génèrent des sensations qui apparaissent et disparaissent en fonction de leur cause. Le pratiquant voit ainsi que ces sensations sont impermanentes, souffrantes et sans soi car elles dépendent des contacts sensoriels.
Q : Aujourd’hui on prend souvent comme support de la méditation la respiration (ānāpānassatī), pourquoi ?
R : Depuis l’époque du Bouddha, la respiration est un support idéal conseillé à tous. C’est la méthode la plus simple car tout le monde respire. La respiration convient à la fois pour Samatha et Vipassanā. On observe la respiration en étant toujours conscient. Être conscient de la longueur, de l’entrée et la sortie de l’air, et de sa finesse ou grossièreté. Durant la pratique, l’esprit unifié et conscient est Samatha. Une fois le calme acquis, on passe à Vipassanā en réfléchissant aux caractères souffrants, changeants, impermanents et non-soi de la respiration. On voit que l’air entre et sort indépendamment de notre volonté, et que la respiration apparaît et disparaît en fonction des causes. L’inspiration peut être vue comme un Khandha (matière), la conscience de la respiration comme Sensation, le fait de savoir sa longueur comme Perception, et la conscience de l’air comme Conscience. On voit que l’air et la sensation qui en résulte sont impermanents, souffrants et non-soi. Il n’y a que des actes ou phénomènes qui apparaissent et disparaissent selon les causes, pas d’individus qui les font. La sagesse qui perçoit ces caractères est Vipassanā.
Q : Que voulez-vous dire par être conscient de l’air qui entre et qui sort ?
R : Être conscient de l’air dès qu’il touche la lèvre supérieure ou le nez au début de l’inspiration, puis le sentir traverser la poitrine au milieu et en bas à la fin. Ne jamais laisser l’esprit s’égarer. Pour l’expiration, l’esprit doit être conscient de l’air qui sort, du début à la fin. Le débutant suit mentalement les étapes de la respiration pour fixer son esprit. Une fois le calme acquis, il suffit de fixer l’esprit à un seul point (bout du nez ou lèvre supérieure) et être conscient de l’air qui y entre et sort. Si l’esprit reste conscient à cet endroit, on a réalisé Samatha.
Q : Certains pratiquants comptent l’inspiration et l’expiration. Cette méthode est-elle valable ?
R : Oui, il existe plusieurs manières de compter la respiration, par exemple de 1 à 5, puis de 5 à 1, et ainsi de suite jusqu’à 10. Il faut faire attention à ne pas compter moins de 5 (esprit dispersé) ou plus de 10 (esprit dévié du support). Une fois le calme acquis, il n’est plus nécessaire de compter, il faut simplement observer le calme le plus longtemps possible.
Q : Quelle est la différence entre l’intelligence et la sagesse dans Vipassanā ?
R : Normalement, c’est la même faculté (cetasika). Dans le bouddhisme, l’intelligence (Paññā) est utile dans la vie quotidienne pour bien vivre et acquérir le confort, mais elle ne supprime pas la souffrance et est source d’attachement. La sagesse, par contre, est supramondaine. Elle permet d’enrayer la souffrance par la claire vision de la nature des phénomènes. Elle peut éliminer les poisons de l’esprit, menant au calme et à la sérénité sans attachement, et donc sans souffrance.
Q : Vipassanā paṭipadā et Vipassanā ñāṇa ; quelle est la différence entre ces deux termes ?
R : Ces deux mots ont un sens similaire avec une nuance. Vipassanā paṭipadā désigne la sagesse née de la pratique de Vipassanā. Vipassanā ñāṇa désigne les différentes étapes de connaissance durant la pratique. Il y a 9 étapes dans Vipassanā ñāṇa, qui décrivent les différentes compréhensions et contemplations menant à la vision des Quatre Nobles Vérités et à la libération.
Q : Quelle est la différence entre Vipassanā-ñāṇa et Visuddhi (la pureté, la splendeur ou l’excellence) ?
R : La première est la connaissance ou la sagesse acquise par la méditation Vipassanā. La seconde (Visuddhi) désigne la pureté de l’esprit, qui peut être acquise par l’éthique (Sīla), la méditation (Samatha), et la sagesse (Vipassanā) qui voit la réalité et éradique les souillures. Visuddhi est le résultat.
Q : Parlez-vous des différentes Visuddhis ?
R : Il y en a 7 : purification de la moralité (Sīla visuddhi), purification de l’esprit (Citta visuddhi), purification de la vision (Diṭṭhi visuddhi), purification de l’abandon des doutes (Kaṅkhāvitaraṇa visuddhi), pureté de la connaissance de ce qui constitue le sentier ou le non-sentier (Maggāmaggañāṇadassana visuddhi), pureté de la connaissance de la méthode menant au noble sentier (Paṭipadā ñāṇadassana visuddhi), et pureté de la connaissance profonde permettant de voir les 4 nobles vérités (Ñāṇadassana visuddhi). Le texte détaille chacune de ces puretés.
Q : Les dix Vipassanūpakkilesas, en majorité, sont méritoires (kusala dhamma), pourquoi les considère-t-on comme des entraves ou des obstacles ?
R : Ils sont positifs sauf le désir subtil (Nikanti). Ils sont considérés comme des obstacles car ils peuvent donner au débutant l’illusion d’avoir atteint l’éveil, l’empêchant de continuer. Pour un pratiquant expérimenté, ce sont de simples signes de l’inspection, pas la vraie réalisation.